La laideur comportementale : pour une esthétisation du mal-être dans Le Voyage initiatique de Noël-Aimé Ngwa-N Behavioural Ugliness: Towards an Aestheticisation of Malaise in Le Voyage initiatique by Noël-Aimé Ngwa-Nguéma
Main Article Content
Abstract
ABSTRACT: Ugliness, from antiquity to the present day, is a recurring concept in literature and the human sciences. It has been developed by authors such as Homer (The Odyssey), Victor Hugo (Notre-Dame de Paris), Kierkegaard (The Sickness Unto Death), Karl Rosenkranz (Aesthetics of Ugliness), Umberto Eco (On Ugliness), and Gwenaëlle Aubry (The (Dis)gust for Ugliness). The aim of their writings is to familiarise readers with the concept so that it becomes “an integral part of a whole which is none other than the work of art” (Gagnebin, 1994:9). In this sense, ugliness may be seen as an “archaeology of knowledge.” In the same vein, Noël-Aimé Ngwa-Nguéma authored Voyage initiatique, a text in which ugliness is distinctly apparent. It is evident through the subjugation and degradation of the Ntsemplois people by Western religious figures. The inhabitants of this town become, to borrow Ngwa-Nguéma’s own expression, “chameleon beings” and “bats.” Ugliness thus appears as a behavioural malaise. The objective of this paper is to demonstrate how, in the studied text, behavioural ugliness becomes a criterion for the readability or aestheticisation of existential distress.
RÉSUMÉ : La laideur, depuis l’antiquité à nos jours, est une notion récurrente en littérature et dans les sciences humaines. Elle est développée par les auteurs tels que (Homère (Odyssée) ; Victor Hugo (Notre–Dame de Paris) ; Kierkegaard (Traité du désespoir) ; Karl Rosenkranz (Esthétique du laid), Umberto Eco (Histoire de la laideur), Aubry Gwenaëlle (Le (dé)gout de la laideur) … Le but de leurs écrits est de vulgariser la notion afin qu’elle devienne « la partie intégrante d’un tout qui n’est autre que l’œuvre d’art » (Gagnebin, 1994 :9). Cela dit, la laideur s’apparente donc à une « archéologie de savoir ». Suivant ce sillage, Noël-Aimé Ngwa-Nguéma commet l’œuvre intitulée Voyage initiatique. Texte dans lequel la laideur est clairement visible. Elle s’entraperçoit à travers l’assujettissement et l’avilissement du peuple Ntsemplois par les religieux occidentaux. Les individus de cette ville deviennent, pour emprunter l’expression de Noël-Aimé Ngwa-Nguéma, des « êtres caméléons » » et « chauve-souris ». La laideur se perçoit alors comme un mal comportemental. L’objectif de ce travail est donc de montrer comment à travers ce texte en étude, la laideur comportementale devient un critère de lisibilité ou d’esthétisation d’un mal être existentiel.
Article Details
LICENSE: This work is licensed under a Creative Commons CC BY 4.0 license
References
• Bastide (Roger), 1996, Les Amériques Noires : Les civilisations africaines dans le nouveau monde, Paris, L’Harmattan.
• Bakhail (Mikhail ), 1970, L’œuvre de François Rabelais, trans. A. Robel, Paris, Gallimard.
• Béji (Hélé), 1997, L’imposture culturelle, Paris, Stock.
• Eco (Umberto), 2007, Histoire de la laideur, Paris, Flammarion.
• Firmin (Anténor), 2003, De L’égalité des races humaines, Paris, L’Harmattan.
• Gagnebin (Murielle), 1994, Fascination de la laideur : L’en-deçà psychanalytique du laid, Paris, Champ Vallon.
• Herencia (Bernard), 2014, « L’optimum gouvernemental des physiocrates : despotisme légal ou despotisme légitime ? » dans Revue de philosophie économique, Paris, Vrin, n°2, vol.14, p.119-149.
• Husson (Laurent), 2020, [La « génération offensée » prise dans « l’imposture culturelle » : à propos de Génération offensée de Caroline Fourest et de L’Imposture culturelle d’Hélé Béji]. Dans Etudes littéraires africaines ; n° 50, p.148-151. https://doi.org§10.7202/1076037ar
• MIKALA (Gyno Noël), 2014, Poétique de la satire dans le roman francophone, Libreville, Amaya.
• Monzéo (Régis Carl), 2021,« Lecture croisée de la laideur et du risible dans Lettre à la France nègre », dans Yambo Ouologuem du mépris à la consécration, Paris, Dianoïa, p.149-162.
• Ngwa-Nguéma (Noël-Aimé), 2008, Voyage initiatique, Paris, L’Harmattan
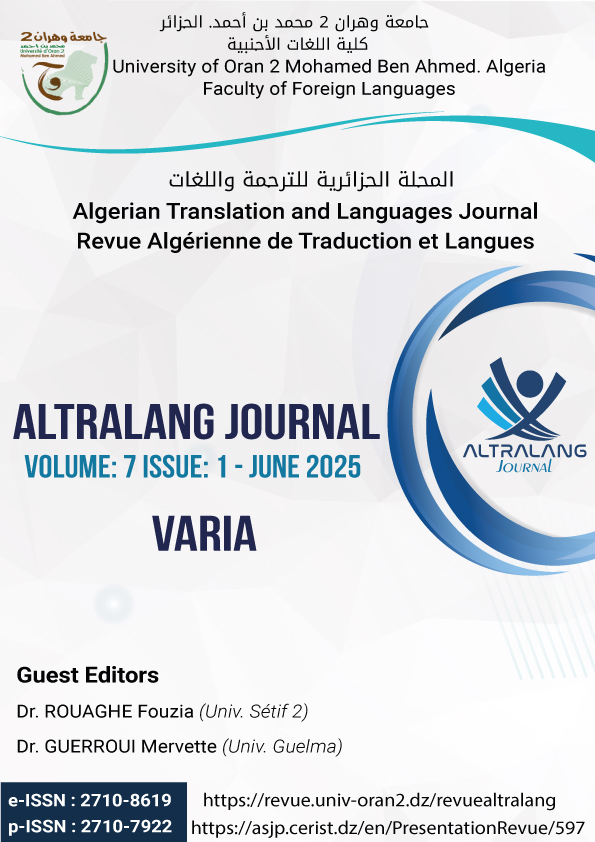
1.png)